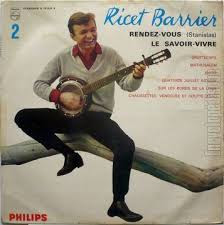Intéressante émission de Jean-Noël Jeanneney, Concordance des temps du 4 mars 2023 consacrée au cas du chanteur le plus célébré de la première moitié du XIXème siècle, Pierre-Jean de Béranger.
Outre faire un résumé de cette gloire populaire du Caveau Moderne et des goguettes (on ne disait alors ni cabarets ni café concerts) ce programme pose une très captivante question : celle de la notoriété ainsi que de sa postérité.
Comment, en effet, un artiste auquel Stendhal, Chateaubriand, Sue, Dumas, Goethe et surtout la plèbe rendirent hommage de son vivant finit-il plus ou moins aux oubliettes ?
La réponse tient sûrement en deux raisons. Une est la cause défendue par ce poète, un république (matinée de patriotisme et de nostalgie bonapartiste) désirée sous la Restauration comme devant guérir tous les maux mais qui se révélera, après les fusillades de juin 1848, pour ce qu'elle fut : un banquet pour la bourgeoisie qui exploita sans vergogne le peuple travailleur. Cette évidence de la lutte des classes rendit bien des œuvres de Béranger caduques.
L'autre raison découle de la première. Décédé au début du second empire, les funérailles de Béranger furent l'occasion d'une mise en spectacle, d'une récupération grossière par un régime déjà dévalué né sous les coups de sabres et de baïonnettes. De quoi vous flinguer une réputation !
Il n'est qu'à comparer avec d'autres enterrements plus tardifs telles celles de Victor Noir ou de Jules Vallès.
Ceci posé, relativisons l'oubli dont souffrit le bonhomme, sa tombe fut longtemps le lieu d'un pèlerinage annuel, il fut mis en musique par Hector Berlioz, Franz Liszt ou Édouard Lalo après sa disparition. De même, plus récemment, il est encore chanté dans de nombreux spectacles et cabarets.
Une de ses interprètes "moderne" fut Germaine Montéro, ici dans Les cinq étages, métaphore du sort d'une femme et du temps qui s'enfuit vues par le biais d'un immeuble parisien.




 -
-